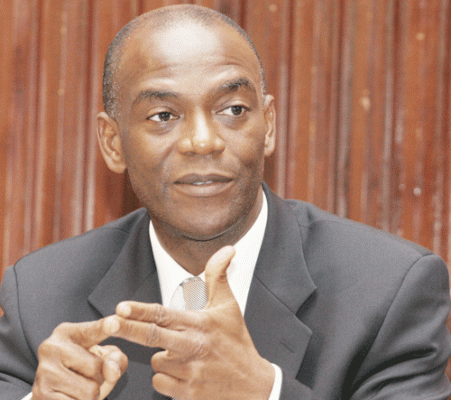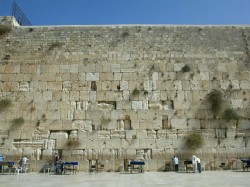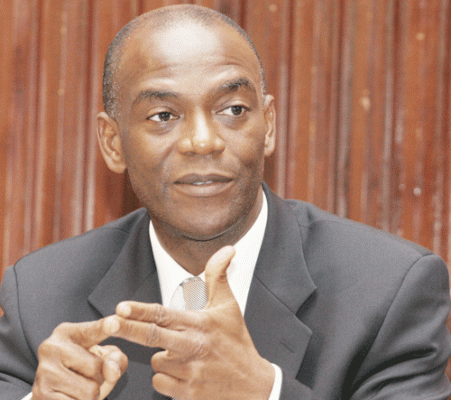 Le quotidien d’information béninois Aube Nouvelle a interviewé Mamadou Koulibaly, transfuge du FPI et Président du Lider (Liberté et Démocratie pour la République).
Le quotidien d’information béninois Aube Nouvelle a interviewé Mamadou Koulibaly, transfuge du FPI et Président du Lider (Liberté et Démocratie pour la République).
Mamadou Koulibaly est l’une de ces personnalités politiques qu’on ne présente plus en Côte d’Ivoire. Agregé d’Economie à 27 ans, cet universitaire Djoula originaire du Nord de la Côte d’Ivoire et actuel Président de l’Assemblée nationale ivoirienne est l’un des caciques du régime défunt à Abidjan.
C’est à lui d’ailleurs que sont revenues les rênes du parti présidentiel, le Front Populaire Ivoirien (FPI) quelques jours après la chute de Laurent Gbagbo. Mais coup de théâtre, il démissionne avec fracas de la tête du parti et quitte le FPI. Mamadou Koulibaly déterminé a apporté sa pierre dans l’édification d’une nouvelle Côte d’Ivoire, a porté, la semaine dernière, sur les fonts baptismaux son propre parti politique dénommé : Lider (Liberté et Démocratie pour la République) dont il est le président. Dans cet entretien exclusif qu’il a bien voulu nous accorder, il répond à nos questions sans langue de bois et sans rien perdre de sa réputation de bouillant homme politique. Sans tabou, il parle de Laurent Gbagbo, du FPI et des raisons de la chute de son régime sans épargner les nouvelles autorités de la Côte d’Ivoire notamment Ouattara. Africaniste bon chic bon genre, Mamadou Koulibaly croit dur comme fer que sans briser les frontières tribales, le mal qui a amené la Côte d’Ivoire à la décadence guette aussi les autres pays africains. Avec son parti, Lider, il propose une nouvelle alternative à son pays et ceci au-delà des clivages ethnicistes et tribaux. Interview…
Aube Nouvelle : Professeur Mamadou Koulibaly, vous êtes Professeur agrégé d’économie à l’université de Cocody à Abidjan, Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, on vous présente comme un grand promoteur de la pensée libérale classique. Vous avez récemment démissionné du Front Populaire Ivoirien, alors que vous venez d’être porté à la tête de ce parti après la chute du régime de Laurent Gbagbo. Pourquoi cette démission ? Est-ce pour exprimer une déception personnelle ?
Mamadou Koulibaly : Merci bien pour la question. J’ai été pendant 20 ans membre du Front populaire ivoirien et ces dix dernières années, je me suis efforcé d’attirer l’attention de mes camarades sur le sens de notre combat, sur l’orientation de notre combat, sur les déviances qui étaient préjudiciables à notre ligne de conduite et à la vie des militants ; malheureusement je n’ai pas été entendu ; j’ai même été combattu parce que revenir à la ligne originelle du FPI gênait pas mal de monde, nous étions au pouvoir et il était question que nous puissions y rester et on ne pouvait se permettre de dévier sans conséquences. Malheureusement les élections sont venues et m’ont donné raison. Ce qui a provoqué mon départ, est que malgré les mises en garde que j’avais pu faire à mes camarades, non seulement on ne m’a pas écouté mais on est allé droit dans le mur. Malgré cela, j’ai essayé d’attirer leur attention sur une orientation que nous pouvions donner à l’opposition une fois que le Président Gbagbo avait été arrêté. Et là encore, je me suis retrouvé mis en minorité au sein de la haute direction du parti qui avait été décapité. Certains voulaient que nous attendions tranquillement que Laurent GBAGBO revienne de sa prison pour nous dire ce qu’il y a à faire. Et moi je pensais que c’étaient nous les hommes et les femmes qui n’étions pas en prison qui pouvions libérer Gbagbo. Entre les deux attitudes, j’ai compris qu’il était difficile pour moi de faire comprendre ma position aux autres. Le parti avait alors trois autres têtes en plus de celle de la direction officielle que je dirigeais à Abidjan. Il y en avait une à Paris et deux à Accra. Il m’était impossible de diriger une telle machine à quatre têtes. Et comme j’avais envie de mettre une opposition forte, une opposition crédible et combative en face de Ouattara, j’ai décidé de démissionner pour créer un parti dénommé : Liberté et Démocratie pour la République (Lider). C’est d’autant plus triste qu’après 20 ans il ne m’était jamais venu à l’esprit qu’un jour je serais parti du FPI mais nous refusons de tirer les leçons de nos erreurs. Il est difficile pour moi qu’après cette crise là, le FPI qui a dirigé la Côte d’Ivoire pendant 10ans, qui pendant 10ans n’a fait aucun congrès de renouvellement de ces structures, pendant 10 ans a géré une crise sans méthode, en soit arrivé à ne pas vouloir faire de bilan, tirer les leçons et construire des perspectives. Il est difficile de construire tant qu’on ne peut pas faire de bilan. Nous sommes allés aux élections sans désarmement alors que dans les accords qui conduisent à la paix, il était nécessaire de faire le désarmement ; nous y sommes allés sans réunification du pays, nous sommes allés aux élections sans qu’il y ait unicité des caisses de l’Etat de Côte d’Ivoire, nous sommes allés aux élections sans redéploiement de l’administration officielle ; toutes ces erreurs là ont fini par nous faire perdre les élections. Il suffisait juste que nous nous réunissions , que nous tirions les leçons, que nous présentions des excuses aux militants, que nous reconnaissions que, en tant que direction nous n’avons pas été à la hauteur et que les militants nous pardonnent et que nous reformulions de nouvelles orientations du parti dans un contexte d’opposition et que nous nous réengageons dans le sens de ce combat. Mes camarades ont trouvé que c’était trop demander et qu’en l’absence de Gbagbo, il n’était pas possible que nous fassions tout cela. Et pour moi, il était difficile de continuer le combat sans bilan. Je suis parti pour tenter d’organiser une opposition en face de Ouattara et c’est ce que je fais.
A.N : Vous venez de créer votre propre parti que vous avez appelé « Lider » et qui s’assigne pour mission la défense des libertés. Doit-on déduire qu’ il n’ avait-il pas de liberté au sein du FPI ? Qu’est-ce qui fera la différence entre votre parti et les nombreux autres qui occupent le paysage politique ivoirien ?
M. K. : Oui, il y a un peu de cela dedans. Le parti s’appelle « Lider » entendez : Liberté et Démocratie pour la République. C’est un parti qui va organiser un plaidoyer en faveur des libertés individuelles, des libertés politiques, la liberté d’entreprise, la liberté de penser, la liberté de culte, de toutes les libertés pas seulement pour la classe politique mais pour tout les citoyens dans une atmosphère d’état de droit et pour la défense des principes de la République. Nous voulons allumer la flamme de la liberté dans le cœur des ivoiriens pour qu’elle devienne l’esprit vital de chacun d’entre eux et qu’ainsi, ils deviennent généreux et acceptent de se supporter les uns les autres et cessent de se battre entre eux pour tout et pour rien. Au FPI nous avons l’habitude de défendre la liberté. Cela fait 20 ans que nous célébrions la fête de la liberté mais nous ne sommes pas arrivés à franchir le pas pour promouvoir les libertés individuelles, la liberté de contrat, la liberté d’entreprise. Nous avons souvent vu des privatisations « gré à gré » que nous avions critiqué souvent sous Ouattara quand il était premier ministre mais une fois au pouvoir nous aurions dû, au nom de la liberté faire des privatisations, utiliser les principes du marché par appel d’offre internationales, nous n’avons pas été capable de cela alors que c’est au nom de l’économie sociale de marché que nous avions gagné les élections de 2000. Il y a beaucoup de manquement que nous avions eu par rapport à la liberté, et Lider aimerait bien renouer avec ces principes fondamentaux de la vie démocratique, des principes qui ont justifié l’engagement de beaucoup de personnes aux côtés de Laurent GBAGBO à l’époque pour la promotion de la démocratie en Côte d’Ivoire.
A.N. : Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes parti du FPI pour aller rejoindre vos frères du nord ?
M. K. : J’ai entendu cela mais il ne faut pas prendre ça très au sérieux. Avant même mon départ du FPI certaines voix du parti se plaisaient à me traiter avec les plus grossières inconvenances Si je devrais aller rejoindre mes frères du nord, je ne serais jamais allé militer au FPI. Ouattara était déjà premier ministre en Côte d’Ivoire quand j’étais jeune prof à la fac, ce n’est pas l’occasion qui a manqué pour m’attirer autour de lui. Mais la perception que j’ai de la politique n’était pas du tout la même que ce que je voyais faire. C’était dans les années 90. Malgré cela je suis allé au FPI. Ouattara est revenu opposant à Bédié puis à Gbagbo Laurent, je ne suis pas allé rejoindre mes frères du nord. Ouattara est devenu Président de la République aujourd’hui, je me demande bien pourquoi ils pensent que j’irai rejoindre mes frères du nord. Ceux qui disent ça sont un peu choqués de la défaite du FPI et du Président Gbagbo et ne sont pas encore arrivés à comprendre ce qui nous est arrivé. Voyez-vous, la classe politique ivoirienne a cristallisé le débat par manque d’idées, par manque d’innovations, par manque de vision et de conviction republicaines, et le débat se résume facilement à des questions tribales. Ce qui fait que des gens comme Koulibaly, nordiste, musulman et dioula se retrouve au FPI un parti de Bété, des gens de l’ouest prétendus « anti-dioula » comme le disent aussi mes détracteurs, ne peut être traité que comme un scélérat. Les nordistes qui eux sont considérés comme tous membres de la grande famille des nordistes au RDR chez Ouattara ; les akans, les baoulés, tous les gens du sud qui se disent akans sont considérés comme Akans au PDCI autour de Bédié ; et la classe politique s’est polarisée. On est soit akan avec Bédié, soit quelqu’un de l’ouest avec Gbagbo soit quelqu’un du nord avec Ouattara. Et c’est une politique de tribalisation qu’une bonne partie de l’élite ivoirienne a intégrée. Et ceux qui sont aussi bien au FPI que dans les autres partis et qui sont imbibés par cette grille de lecture, n’ont jamais compris et peut être même accepté que Mamadou Koulibaly musulman du nord ne soit pas au RDR mais plutôt au FPI, un parti supposé de chrétiens de l’ouest. Et pour ces personnes, quand ce sont les gens du RDR, des nordistes qui le disent « je suis un scélérat, un vendu, un traitre à la cause des sudistes », quelqu’un qui est perdu donc un gars à abattre parce qu’il a fait le choix d’aller militer dans un parti qui est anti-nordiste. A l’époque on me présentait comme le dioula de service chez les gens de l’ouest. Pour ceux du FPI même qui me regardent, j’ai jamais pensé qu’ils seraient allés jusqu’ à me le dire fortement, mais à différents moments il m’a été rappelé que j’étais là juste pour donner une coloration nordiste à la chose qu’ils avaient, à leur pouvoir. J’ai entendu cela même à des réunions officielles. Ce sont les mêmes qui disent que Affi Nguessan qui est un akan, est là pour donner une coloration akan au parti de l’ouest. koulibaly est là pour donner une coloration nordiste au parti de l’Ouest mais le fond du parti reste de l’ouest. Cela n’a jamais été ma conception. Je ne suis pas allé au FPI parce que je cherchais à représenter un groupe ethnique au sein d’un parti. J’y suis allé parce que le FPI avait une vision à l’époque, le FPI avait des valeurs, le FPI avait un idéal. Je serai porté à m’accrocher aux questions ethniques que je ne serais pas allé militer au FPI. Pour ceux qui ont une grille de lecture tribale, il faut les inviter à sortir de cette grille de lecture. Koulibaly n’est pas le représentant d’un groupe ethnique nulle part, il n’a jamais prétendu à cela, il ne militera jamais dans un parti pour des raisons ethniques. Malheureusement avec la crise post électorale, je me suis rendu compte que beaucoup était au FPI pour des raisons tribales et n’avaient aucune conviction politique, aucune vision politique, mais ils y étaient parce qu’ils sont du village de Gbagbo, ou de la région de Gbagbo ou du département de Gbagbo. Et ils ne comprennent pas qu’au FPI il y ait d’autres personnes qui ne soient pas présentées de cette façon là. Et que toutes les personnes de l’ouest ne sont pas venues au FPI pour des raisons tribales. De même que de nombreux autres militants de ce parti qui partageaient un même idéal que Laurent Gbagbo. C’est une très mauvaise analyse, une faiblesse psychologique et une faiblesse politique. Heureusement ils ne sont pas nombreux ceux qui pensent ainsi. C’est d’ailleurs ce qui a perdu le FPI. On aurait pu continuer notre lancée comme un grand parti si le tribalisme n’était pas venu gangréner le FPI au point de perdre le président GBAGBO qui s’est laissé emprisonner par un clan tribal.
A. N. : Depuis l’arrestation du Président Laurent Gbagbo, l’avez-vous revu ?
M. K. : Non. Je n’ai pas pu. J’ai essayé quand j’étais encore au FPI. Chaque fois que j’ai eu l’occasion de parler aux autorités au pouvoir, on m’a dit qu’il fallait attendre, que c’était trop chaud pour le faire, que les procédures étant en cours qu’il fallait attendre. On me dit d’attendre. Et maintenant que je ne suis plus au FPI peut-être qu’on ne jugera même plus utile de me laisser le rencontrer. Mais j’aimerais bien rencontrer Laurent GBAGBO pour savoir quelle est sa lecture de la situation actuelle, quels sont ses regrets, quelles sont ces analyses par rapport à tout ce qui s’est passé, lui faire part de toutes les tentatives que j’ai pu faire en son absence pour réorganiser le FPI et de toutes mes déceptions par rapport à cette réorganisation et mes perspectives que je trace avec le nouveau parti et puis savoir ce qu’il pense de tout ça. Je continue de me battre pour pouvoir obtenir l’amélioration de ces conditions de détention et surtout un traitement digne et équitable par la justice qu’elle soit locale ou internationale, à défaut d’obtenir sa libération pure et simple. Laurent Gbagbo et les autres prisonniers de guerre de Ouattara ne doivent pas subir une vengeance justicière. Un justice des vainqueurs. Lider s’opposera à ce type de traitement.
A. N. : Professeur Mamadou Koulibaly, vous qui avez vécu de près les derniers événements en Côte d’Ivoire, Comment entrevoyez-vous la reconstruction de ce pays ?
M. K. : Je pense que ça va être une reconstruction difficile. Parce que la classe politique reste fortement imbibée dans le tribalisme. La classe politique reste fortement imbibée dans la division ethnique, fortement imbibée dans la division régionale. Or tant qu’il en sera ainsi, les haines vont continuer et il est difficile de faire la reconstruction avec des personnes haineuses. Ce que je crois, c’est que politiquement les choses sont en train de revenir progressivement en l’état On entend de moins en moins des coups de feu, il y a encore des exactions graves de temps à autre, mais le taux est en train de baisser. Et nous avions, il y a un mois, de nombreux barrages un peu partout sur le territoire et en particulier à Abidjan, le nombre de barrages a fortement diminué, mais les guerriers des forces républicaines sont encore dans les rues avec des armes , les policiers et les gendarmes n’ont pas encore correctement repris fonction dans les commissariats et les gendarmeries, la police judiciaire, la police criminelle, les différentes branches de la police civile ne sont pas encore en place, et il y a donc des poches d’insécurité et d’exécutions extra judiciaires un peu partout sur le territoire national. Et tant qu’il y aura ces poches d’insécurité, je doute fort que des entreprises veuillent s’installer, que les libertés individuelles puissent être exercées, je doute fort que la relance puisse se faire malgré les milliards de francs qui sont promis. A côté de cela, il y a le gouvernement lui-même, le président Ouattara fonctionne en hyper président. Il gouverne par décrets et ordonnances, il décrète la dissolution de l’Assemblée Nationale sans prendre de texte formel mais de façon totalement illégale. Il adopte un budget de 3.050.milliards prélevés dans les poches des ivoiriens sans avoir leur consentement par quelque représentant que ce soit mais simplement par ordonnance. Il nomme des membres du conseil constitutionnel en suivant une procédure totalement contraire à la constitution sur laquelle pourtant il à prêté serment. Tout cela n’est pas fait pour rassurer et la population, et la classe politique et la communauté internationale. J’espère qu’assez rapidement nous aurons les institutions mises en place pour aller vers l’état de droit. Pour le moment on est encore dans un état d’exception et il est toujours difficile de reconstruire dans un état d’exception. Mais le grand mal qui dirige tout ça, c’est la haine, une haine tribale, et Lider justement entend s’émanciper de toutes ces haines, entend proposer un cadre qui s’inscrirait à égale distance de tous ces pôles ethnicistes pour créer un rassemblement autour de la Côte d’Ivoire. Un rassemblement qui pourrait proposer aux ivoiriens une alternative crédible et pourquoi pas une alternance le plus rapidement.
A. N. : Quelles leçons les pays africains peuvent-ils tirer de cette crise qui a dévasté la Côte D’Ivoire ?
M. K. : Il est difficile de faire de la démocratie en se fondant sur les divisions ethniques. Lorsque les élites africaines, la classe politique africaine, s’émancipera des pièges du tribalisme et de l’ethnicisme, on aura déjà gagné. En Côte d’Ivoire, tout a commencé avec « l’ivoirité » et ça s’est terminé avec des guerres insensées, abominables qui ont fait d’énormes morts parce qu’on a tiré sur la fibre tribale pour coaliser les ethnies les unes contres les autres, et aujourd’hui on en paie le prix fort. Si les pays africains peuvent comprendre qu’ils peuvent faire de la politique sans se fonder sur des considérations ethniques, mais simplement en proposant des programmes fédérateurs à leurs peuples plutôt qu’en les divisant ethniquement pour pouvoir les commander, ce sera déjà un gros avantage. Rassembler pour gouverner est un principe bien meilleur que diviser pour régner. Cela c’est la première leçon. La deuxième, c’est l’état de droit. Par l’Etat, on entend gouvernement sorti des urnes, mais un état de droit doit s’entendre aussi au même sens qu’ « état de pesanteur » c’est-à-dire un Etat dans lequel le droit s’impose à tout le monde y compris les hommes politiques à commencer par le premier d’entre eux le Président de la République. Que les hommes politiques puissent comprendre qu’ils sont les serviteurs de la population et non les maîtres. Troisième leçon, comprendre que la parole donnée est importante. Lorsqu’on signe des accords et qu’on prend des engagements, le strict minimum qu’on demande à un homme politique qui veut faire respecter son leadership, c’est le respect de la parole donnée. Rouler les gens, faire des faux coups, des coups tordus est devenu un principe des classes politiques africaines. Quand on dit que tel est un bon politicien en Afrique, c’est qu’il a le génie des faux coups. Il faut que les cadres africains sortent de ce piège. On peut faire de la politique en respectant la parole donnée, en respectant la liberté de contrat. Et la dernière leçon que j’aimerais souligner, c’est de croire que la communauté internationale peut résoudre tous les problèmes des pays africains. C’est vrai que quand nous avons besoin d’aide pour financer le développement, nous nous adressons à la communauté internationale qui apporte l’aide publique, quand nous avons besoin de régler nos crises, nous nous adressons à la communauté internationale qui apporte les casques bleus, et les armées mises en place par le cadre du conseil de sécurité des nations unies, mais tout cela ne fait que nous enfoncer dans notre propre dépendance. Il est possible que si nous changeons nos comportements, notre façon de faire, que nous sortions de ce piège. Regarder en Somalie, on passe le temps à faire des guerres, et maintenant qu’il y a la famine on demande à la communauté internationale de venir aider, alors qu’il aurait suffi d’appliquer les principes de propriété privée des sols, de liberté de commerce des populations, de l’Etat de droit en Somalie, que ce pays aurait pu produire pour nourrir ces populations et même exporter ailleurs les surplus. Nos famines, nos guerres ne sont que les résultats des mauvaises politiques économiques, les mauvaises privations des libertés. La communauté internationale peut faire l’appoint mais ne peut jamais se substituer à nos solutions. Et ces solutions sont toujours humiliantes pour nous .
Ce qui s’est passé en Cote d’Ivoire a été humiliant pour Gbagbo Laurent, pour Mamadou Koulibaly, humiliant pour les militants du FPI, humiliant pour toute la classe politique ivoirienne, et humiliant pour les peuples africains. On peut tirer d’énormes leçons mais voilà quelques unes que je voudrais partager, les historiens et le temps se chargeront du reste.
A. N. : Vous avez lancé il y a deux ans Audace Institut Afrique ( AIA) , un « Think tank » qui propose une vision libérale du progrès et assure la promotion des droits humains et des libertés économiques. Quelles sont réellement les activités de cet institut ?
M. K. : Cette année le programme d’Audace Institut Afrique a été fortement perturbé par la crise ivoirienne Néanmoins des choses ont été faites, notamment l’audit des libertés économiques en Côte d’Ivoire. Nous entendons élargir l’audit des libertés aux pays francophones d’Afrique de l’ouest pour que progressivement, les populations, les élites, les intellectuels prennent conscience du degré de liberté économique des pays dans lesquels ils vivent, et que des solutions soient proposées pour améliorer les libertés économiques qui sont à la base de la prospérité des peuples. En plus de cela nous avons un institut qui fait du leadership, qui recrute des étudiants par leur assiduité, leur sérieux, pour former des activistes qui peuvent dans leur pays être à la disposition de la cause des libertés individuelles, la cause le l’économie de marché. L’institut part du principe que nos Etats sont en loque et qu’au lieu de nous battre pour les gérer il nous faut commencer par comprendre quel doit être la frontière de leurs actions. AIA forme les jeunes à cet esprit pour qu’ils comprennent que l’avenir est ouvert et que le futur ne leur est pas inaccessible. L’audace est enseignée dans cet institut pour renforcer la croyance des participants en leur propre liberté comme force de changement social en Afrique.
A. N. : Pour conclure cet entretien, un mot à l’endroit de la jeunesse africaine
M. K. : Merci pour cet entretien. Les jeunes africains devraient sortir de la désespérance et l’idée selon laquelle tout est perdu pour eux et qu’il faut aller au bout du monde la- bas chercher leur avenir. Je ne suis pas contre ceux qui vont à l’extérieur chercher leur avenir, je les encourage d’ailleurs à le faire. Mais en même temps il faut que les jeunes africains sachent que quel que soit l’endroit où ils sont, les portes ne sont jamais fermées. S’il leur arrive à un moment donné de désespérer de l’avenir, qu’il clique sur des liens qui sont à leur disposition à partir d’Audace Institut Afrique Qu’ils se disent qu’il y a un institut à Abidjan, il y en a d’autres en Afrique et dans le monde qui proposent une alternative qui sort de l’assistance, de l’étatisme, de la désespoir et qui ouvrent la porte de toutes les libertés que le monde offre aujourd’hui aux hommes. La mondialisation et les nouvelles technologies de la communication offrent d’énormes possibilités aux jeunes mais n’en profitent vraiment que ceux qui se forment correctement dans les grandes écoles et universités du monde. Ceux qui sont mal éduqués ou pas éduqués du tout en pâtissent en général. Les jeunes africains doivent se former car ils vivent dans un monde ou leur concurrent sur le marché du travail n’est pas le voisin de classe mais de nombreux autres jeunes là bas dans les universités américaines et chinoises et d’ailleurs dans le monde.
Propos recueillis par Eugène ABALLO pour AUBE NOUVELLE